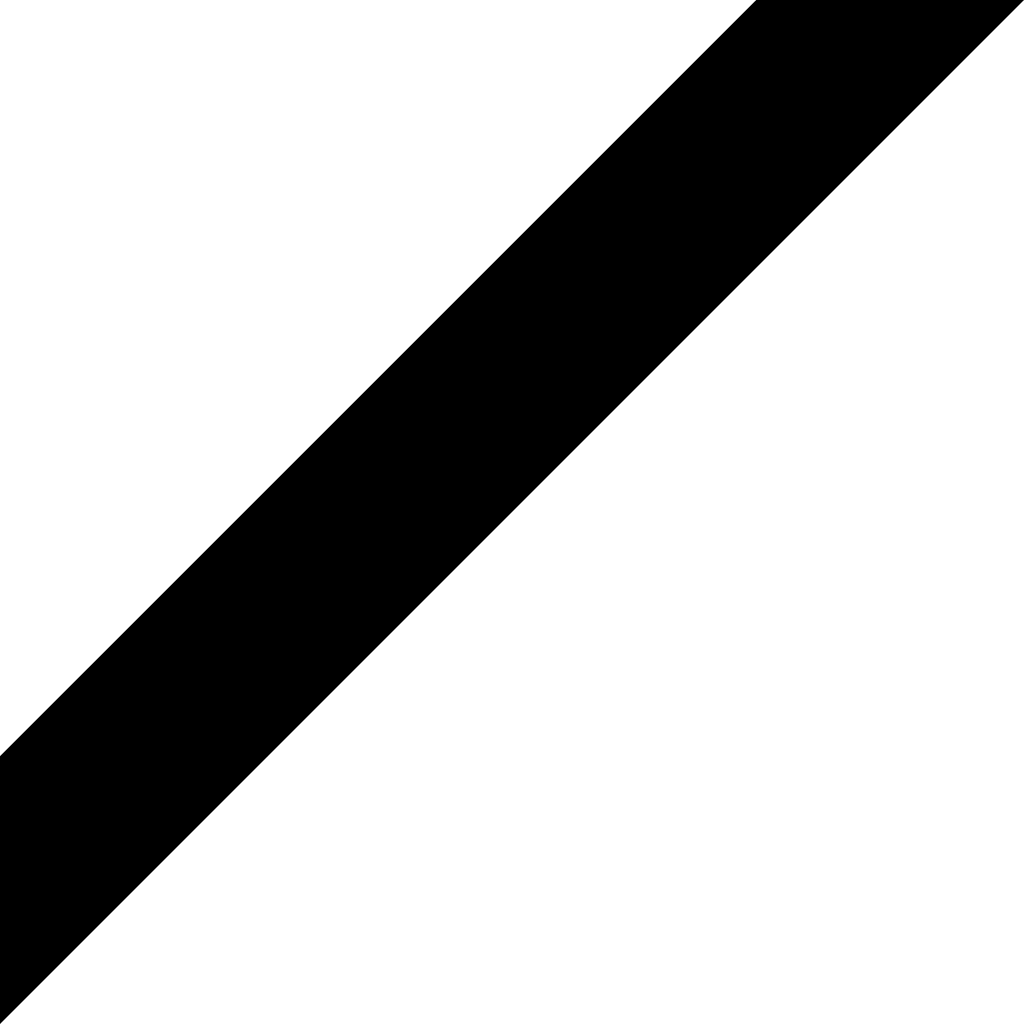
C’était un jeudi, à quelques jours de la rentrée. Il faisait un beau soleil bien franc, bien ferme, bien déterminé à nous faire sentir tout le poids de la chaleur de l’été. Et sans vraie surprise, ils étaient là. Je les ai tous trouvés tellement beaux, tellement grands, tellement déjà adultes dans leurs beaux costumes noirs et élégants. Je les ai retrouvés bien transformés, avec tout l’épaisseur des émotions qu’ils partageaient. Je les ai trouvés tellement grandis, mes pioupious de 1STI2D !
C’était une classe bien singulière : ma dernière classe de première avant la réforme du lycée, ma première classe de STI2D, une classe dont j’étais professeure principale. Mieux, en vérité : une classe dont j’ai été heureuse et fière d’être professeure principale. Il y a des classes, comme cela, qui marquent longtemps parce qu’on a vécu avec elles, avec eux, une aventure particulière, faite un peu d’étude de textes et de dissertation mais surtout de beaucoup d’humanité, de coups de colères et de fous rires, de tout ce qui se partage, humainement, dans une salle de cours et que les tableaux excel ne sauront jamais enfermer.
Dans cette classe, il y avait un élève en fauteuil et cela générait quelque chose de très positif, un souci permanent du confort et du bien-être de ce camarade un peu singulier et tellement attachant, un souci tellement ouvert et généreux qui donnait le ton du groupe. L’AESH avait tout ce qu’il fallait d’aide et de soutien pour accompagner son élève, notre élève !
Dans cette classe, ils étaient souvent potaches, mais jamais méchants. Quand ils me saoulaient trop, je leur disais invariablement qu’ils me donnaient envie d’aller élever des chèvres dans la Larzac. Au bout d’un semestre, dès qu’ils sentaient le ton monter, il y en avait souvent un pour me demander « Vous voulez aller élever des chèvres, là ? »
Avec cette classe, essentiellement de garçons, nous avions travaillé à des discours d’éloges de femmes admirables. Certains avaient choisi des scientifiques. Leurs affiches décorent toujours les murs d’une des salles informatiques. L’année dernière, plusieurs élèves de mes classes avaient été curieux de ces affiches et de la classe qui les avaient réalisées et cela m’avait fait plaisir : ce petit projet de classe produit encore du sens aujourd’hui qu’ils ont quitté le lycée.
Pour cette classe, j’avais demandé une dédicace personnalisée à Maylis de Kerangal de Naissance d’un pont. J’avais scanné la dédicace et j’avais fabriqué pour chacun un marque-page. Ils avaient été très touchés : tout à coup, la littérature devenait quelque chose de tellement vivant, de tellement charnel. Et puis ils étaient émus, au fond, qu’une écrivaine ait ainsi écrit quelque chose tout exprès pour eux. Ce que peut provoquer une si modeste trace manuscrite !
Ce n’était pas une classe de ceux qu’on nomme des littéraires et pourtant, il me semble qu’autour de cet objet que nous appelons littérature, avec ces jeunes gens débordants de vitalité et de curiosités, nous avions réussi à constituer un petit salon confortable et ouvert sur le monde et sur les autres. J’ai souvenir de très belles anthologies poétiques qu’ils avaient composées, en fin d’année. J’ai souvenir de vraies surprises au moment du déploiement du sens de « L’horloge » de Baudelaire ou encore de « la bicyclette » de Jacques Réda. J’ai le sentiment que la poésie, avec eux, ce n’était vraiment, finalement, pas rien et c’est tellement important de partager cela avec des élèves !
C’était un jeudi, à quelques jours de la rentrée. Ils étaient beaux, tous vêtus de leurs trois années de plus et de leurs beaux costumes sombres.
L’un d’entre eux reposaient là et c’était inacceptable.
L’un d’entre eux a été fauché sur la route et, soudain, les statistiques d’accidentologie du weekend du 15 août ont sonné un glas parfaitement insupportable.
L’un d’entre eux reposait là et si j’étais tellement touchée de les retrouver tous, et de les saluer tous, et de leur dire combien ils sont beaux, tous, j’aurais préféré que nous n’ayons jamais eu cette occasion de nous revoir.
L’un d’entre eux, désormais, repose là.
Un cimetière n’est pas un lieu bien drôle pour une rencontre.
A quelques jours de la rentrée, accompagner un de ses anciens élèves au seuil du dernier voyage, un élève tellement généreux, joyeux, ouvert, curieux, un garçon tellement débordant de vitalité, un garçon à l’avenir tellement prometteur, ça donne sacrément à réfléchir, outre ce que ça donne à regretter et pleurer.
Heureusement, depuis quelques jours, je rencontre mes nouveaux élèves et je retrouve même des anciens. Et la vie l’emporte, parce que la vie doit toujours l’emporter évidemment. Mais c’est une rentrée à la tonalité un tout petit peu différente, avec un fond de gravité supplémentaire dont les élèves ne savent évidemment rien mais sans doute peuvent-ils en percevoir un petit quelque chose.
Et cette gravité nouvelle est invitation à se souvenir de ce qui compte vraiment. Retour aux fondamentaux, donc, comme au rugby. Alors, qu’est-ce qui compte vraiment, dans une salle de cours de français ? Ce n’est pas la capacité à savoir rédiger un commentaire ou une dissertation. Non. Jamais, en fait, sauf, éventuellement, à un mois des épreuves du bac. Ce n’est pas la capacité à savoir faire la différence entre une négation totale et une négation partielle, sauf, éventuellement, à un mois de l’oral de l’E.A.F. et de sa fameuse/fâcheuse question de grammaire. Ce n’est même pas d’avoir son matériel ou de savoir se tenir tranquille. Le fond de ce que nous avons à vivre ensemble n’est pas de se préparer à se conformer aux règles des exercices du baccalauréat et aux règles du « monde » en général.
Voici l’expression de ce que sont les vrais fondamentaux pour moi, aujourd’hui : la littérature est une matière vivante et vibrante qui permet à chacun, à chacune, de pouvoir sortir des limbes les matériaux indispensables pour dire : voici qui je suis, voici ce qui vibre en moi de fort et de puissant, voici de qui m’agite, me meut et m’émeut. Voici ce qui fait de moi un être humain qui se tient face au monde et dans le monde. La littérature se prête bien au rituel de la classe puisque, autour d’un objet, qu’il s’agisse d’un petit sonnet ou d’un immense roman, chacun, chacune peut articuler son expérience du monde, l’expression de son identité et cette de son altérité.
Un jour, j’ai entendu quelqu’un dire qu’au fond, étudier la littérature, cela revient toujours à pratiquer l’art de la conversation. Que mes salles de cours soient cette année d’abord et avant tout un lieu où l’on converse, expérience riche et passionnante où chaque voix peut trouver sa place afin que chaque élève puisse élaborer, un peu, sa propre voie vers le monde des adultes. Et que chaque classe constitue une petite société débordante d’humanité.
Alors évidemment, on fera de la méthodo, et de la grammaire, et des lectures, et des fiches de lectures, et des exposés, et des commentaires et toutes ces choses scolaires qui ne sont pas le but mais uniquement le chemin.
Je fais le vœu, cette année, de cultiver ce qui fait, pour moi, l’essence et le fondement du geste professoral. C’est le meilleur hommage que je puisse rendre à rendre à notre ancien délégué de la classe de 1STI2D.
Marie-Claude Pignol
